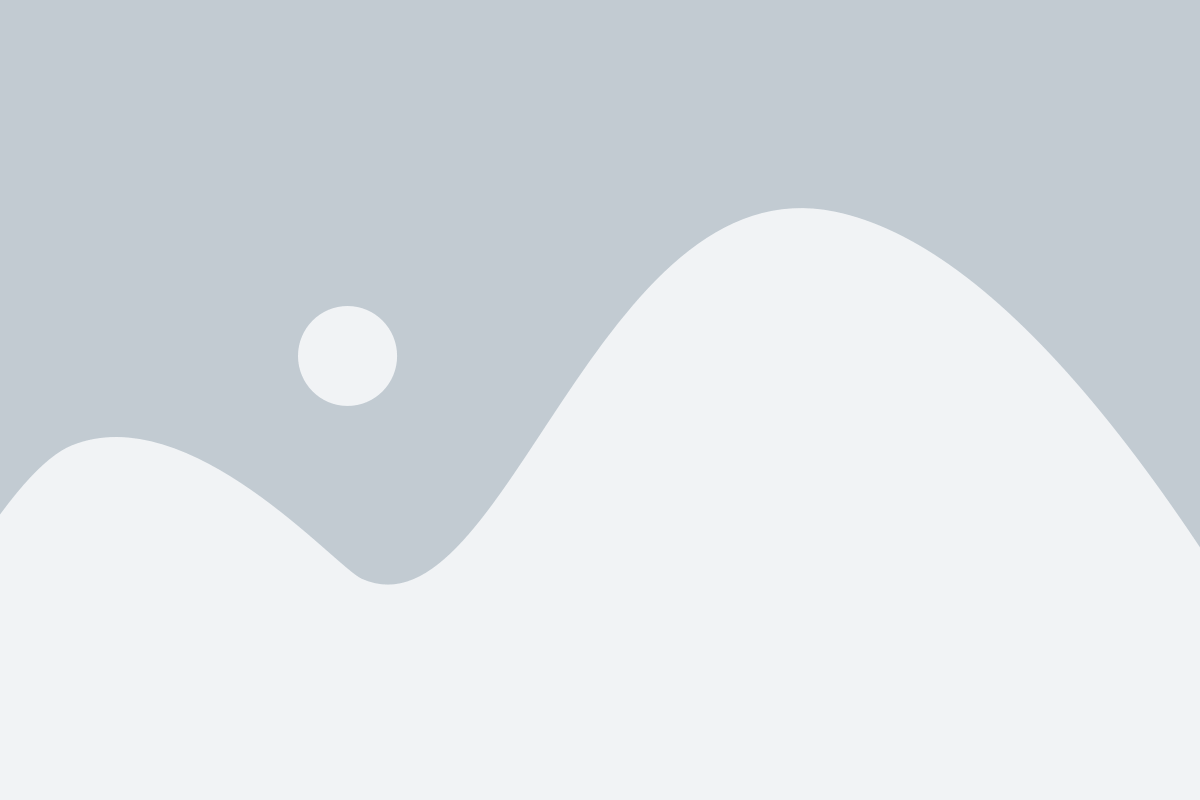Par décret du 7 avril 1866, Victor Duruy étant ministre de l’Instruction publique, l’insigne brodé des palmes napoléoniennes est transformé en une décoration portative, indépendante du costume universitaire, médaille suspendue à un ruban. Duruy s’est adressé à Napoléon III pour que les palmes puissent être portées par tous : « Je prie Votre Majesté de vouloir bien, en signant le décret ci-joint, régulariser cette coutume, qui permettra à un instituteur de village de gagner, par de bons et loyaux services, l’insigne que le ministre de l’Instruction publique s’honore de porter dans les cérémonies officielles, comme les maréchaux de France portent la Médaille militaire que Votre Majesté confère aux simples soldats. »
« Bœuf de labour »
Victor Duruy est né le 10 septembre 1811 à Paris, dans un logis de la manufacture des Gobelins. Sa famille, originaire des Pays-Bas, est venue s’établir en France au temps de Colbert — alors que tant de Français protestants partaient alors aux Provinces-Unies. Sept générations se sont succédé dans la maison royale et son père en est considéré comme l’un des meilleurs ouvriers. Ce dernier commande également une compagnie de la garde nationale, ce qui contribue à ancrer le jeune Victor dans une atmosphère libérale, voire anticléricale, qui cultive le souvenir de l’Empereur et de la Révolution ; « la devise de mon père était ordre et liberté », dira-t-il plus tard. II fréquente l’école de la paroisse Saint-Médard, rue du Pot-de-fer et suit des cours de dessin à la manufacture des Gobelins, travaillant même à l’atelier pour devenir apprenti. Comme il lit beaucoup, on conseille à son père de lui faire suivre des études dans une bonne institution — le futur collège Rollin. À Pâques 1824, il devient pensionnaire au collège Sainte-Barbe, obtient une demi-bourse et y passe six années. Fier de porter l’habit de son père et de sa condition de boursier, il se qualifie de « bœuf de labour ».
Le 26 juillet 1830, il s’inscrit à la Sorbonne pour se présenter le lendemain au baccalauréat. Mais c’est en pleine révolution des Trois Glorieuses qu’il le passe, ainsi que les épreuves de l’École normale. Le 28, la garde nationale se reforme et Victor s’échappe de son pensionnat pour rejoindre son père, se procurant uniforme et bonnet à poil. La petite troupe doit rétablir l’ordre dans le quartier, des prisonniers s’étant révoltés à Sainte-Pélagie. Finalement, après trois jours dans la garde nationale, il se rend à Louis-le-Grand pour sa composition d’École normale, décidé, en cas d’échec, à s’engager dans l’armée d’Afrique. Il entre dernier à 19 ans à Normale, mais sort premier à l’agrégation d’histoire trois ans plus tard.
En octobre 1833 il enseigne pendant un trimestre au collège de Reims. En janvier 1834, il enseigne l’histoire au collège Henri IV et devient ainsi maître des enfants du roi Louis-Philippe, puisque les ducs d’Aumale et de Montpensier doivent avoir un maître d’histoire intelligent et jeune. Il se trouve plus particulièrement attaché à Aumale — qu’il fréquentera encore sous la IIIe République —, lauréat du concours général et vainqueur sur les champs de bataille d’Afrique. Malgré sa position près des enfants du souverain, Victor Duruy doit attendre douze ans un titre de professeur : en 1845, il devient second professeur au lycée Saint-Louis. Dans son éloge, l’historien Ernest Lavisse le dépeindra ainsi :
« Il n’enseignait pas l’Histoire pour elle-même, pour le plaisir de raconter des scènes ou d’énumérer des faits. Il étudiait toujours et partout l’homme, l’homme individu, l’homme groupé en États et en nations, et tout l’homme, le soldat, le citoyen, le penseur et l’artiste […]. Et sa curiosité était universelle. Régulièrement, il se tenait au courant des voyages et des expéditions. Régulièrement, il s’informait des faits de la vie sociale et politique ; régulièrement, il suivait les progrès de la science […]. Il était à la lettre un homme à qui rien d’humain n’est étranger. Ce fut l’honneur et le charme de sa vie, et c’est par là qu’il fit un professeur excellent, un homme qui parle à des enfants avec la volonté d’en faire des hommes ».
D’ailleurs, Duruy dira lui-même : « L’esprit des enfants est un livre où le maître écrit des paroles dont plusieurs ne s’effacent pas. »
Atypique
Après avoir été un temps secrétaire de Michelet et avoir vainement brigué le rectorat d’Alger, il rencontre en 1859 pour la première fois Napoléon III qui a commencé à lire son Histoire des Romains et des peuples soumis à leur domination — une période qui intéresse l’empereur — dont les deux premiers volumes ont été publiés en 1843-44 ; en outre, il commence à travailler à La vie de César, ce qui les amène à discuter des institutions romaines. Sa carrière s’accélère : en février 1861, il est nommé maître de conférences à l’École normale, puis inspecteur de l’académie de Paris ; en février 1862, grâce à Hortense Cornu, il accède au rang d’inspecteur général, puis devient titulaire d’une chaire d’histoire à Polytechnique. Il est alors appelé auprès de Mocquard, le secrétaire du souverain. Le 23 juin 1863, après avoir refusé les Cultes, il devient ministre de l’Instruction publique. « Comment Votre Majesté a-t-elle songé à faire de moi un ministre ? » demande-t-il. « Ça ira bien », répond le chef de l’État. L’intéressé précisera plus tard : « Je n’ai jamais reçu de l’Empereur d’autres instructions que ces paroles ». Celui-ci lui a effectivement laissé carte blanche.
De son milieu familial le ministre apporte une connaissance de l’artisanat, un sens pratique et la nécessité d’adapter l’école au monde du travail et aux transformations économiques et sociales de l’époque. De ses années à Normale il est sorti avec une solide formation d’historien capable d’analyser le présent et d’envisager le futur en s’appuyant sur une connaissance approfondie du passé. De son expérience du professorat et de l’inspection il tire des observations permettant de pointer les manques du système éducatif, notamment un enseignement trop général, sans connaissances se rapportant aux métiers que les élèves exerceront, par exemple dans le domaine agricole. Devant les élèves de Polytechnique, il affirme ainsi la nécessité d’une culture générale alliant les sciences et les lettres.
Pendant six ans, jusqu’en 1869, Victor Duruy reste ministre. Sa nomination est jugée comme favorable à la démocratisation du régime par les uns et comme « un caprice de despote » par les autres. N’appartenant pas au sérail politique, il est souvent considéré comme un intrus au gouvernement. Mais ses nombreux échanges avec le souverain et leurs communes préoccupations sociales ont créé des liens et de la confiance : il est souvent sollicité comme conseil de la part de l’empereur. « Napoléon III trouvait en M. Duruy le sincère sentiment démocratique, la générosité d’instinct, la foi aux idées, le patriotisme idéaliste et le même amour philosophique de l’humanité », écrira Ernest Lavisse (1841-1922), attaché à son cabinet en 1867, professeur du prince impérial, fort estimé de l’impératrice en 1867 et ensuite son successeur à la tête des manuels édités par Hachette.
Le ministre ordonne deux grandes enquêtes. La première constitue un état des lieux des établissements scolaires depuis l’école de village jusqu’au Collège de France : Statistiques de l’enseignement primaire, de l’enseignement moyen, de l’enseignement supérieur. La seconde concerne les institutions à l’étranger — Royaume-Uni, Belgique, pays allemands, Suisse, États-Unis — et elle se fonde sur des missions qui y ont été envoyées ou sur des rapports de diplomates. Le ministre va alors faire preuve de réalisme et d’ingéniosité.
De la loi Guizot à la loi Duruy
Ce qu’on appelle à cette époque l’instruction publique se trouve en pleine évolution. En 1828 a été créé un ministère de l’Instruction publique distinct des Affaires ecclésiastiques, avec Antoine Lefebvre de Vatimesnil (1789-1860) comme premier titulaire. Entre 1832 et 1866, le nombre d’élèves passe de 1,9 million à 4,5 millions — n’atteignant 5 millions qu’en 1880. Napoléon avait délaissé l’enseignement primaire et c’est la loi Guizot du 28 juin 1833 qui lui a permis de se développer sous le contrôle de l’État. Les principales dispositions en étaient :
- Chaque commune doit ouvrir une école publique de garçons et entretenir un maître ;
- Chaque commune doit prendre en charge les enfants d’indigents mais il existe un chiffre à ne pas dépasser d’admissibilités gratuites;
- La loi définit le contenu de l’enseignement élémentaire : l’instruction morale et religieuse, la lecture, l’écriture, les éléments de la langue française et du calcul, le système légal des poids et mesures ;
- Pour la formation des maîtres il est prévu d’ouvrir une école normale primaire par département ;
- La loi instaure un enseignement primaire supérieur dans les communes de plus de 6 000 habitants ;
- En 1835, on crée un corps d’inspecteurs départementaux.
Ensuite, la loi Falloux de 1850 établit la liberté de l’enseignement primaire, encourage l’enseigne-ment congréganiste féminin mais charge les communes de plus de 800 habitants d’ouvrir une école de filles.
La loi du 10 avril 1867, dite loi Duruy, dresse une nouvelle configuration. Ses caractéristiques visent à :
- Augmenter le nombre d’écoles publiques en décidant que c’est le conseil général — et non plus les conseils municipaux — qui détermine le nombre d’écoles publiques souhaitables dans chaque commune ; entre 1864 et 1867 plus de 2 167 établissements primaires sont créés pour 227 884 élèves supplémentaires ;
- Créer 2 000 écoles de hameaux et 8 000 écoles de filles en abaissant de 800 à 500 habitants le seuil qui oblige les communes à ouvrir une école publique de filles — Duruy montrant ainsi sa priorité pour l’essor de l’instruction féminine ;
- Autoriser les communes à lever une imposition spéciale pour financer la gratuité et recommander de créer une Caisse des écoles, « destinée à encourager et faciliter la fréquentation de l’école par des récompenses aux élèves assidus et par des secours aux élèves indigents » ; le principe de l’obligation et de la gratuité est posé : « dans un pays de suffrage universel, l’enseignement obligatoire étant pour la société un devoir et un profit, doit être payé par la communauté » — admis par l’empereur mais rejeté par son gouvernement ;
- Etendre les programmes de l’instruction primaire en incluant l’histoire et la géographie parmi les disciplines obligatoires — Duruy étant lui-même l’auteur d’une Petite histoire de France pour le primaire, s’inscrivant parmi les historiens qui vont renouveler l’enseignement de l’Histoire ;
- Réformer les études dans les écoles normales d’instituteurs : dès le 12 février 1867, un décret y a prévu la création de cours agricoles, avec un jardin installé pour les exercices pratiques ; dans chaque département, on crée un poste de professeur d’agriculture chargé d’enseigner dans les écoles normales et de donner des conférences aux agriculteurs ; un enseignement agricole est assuré dans les écoles rurales, des notions industrielles sont introduites dans les écoles des villes et les travaux d’aiguilles, la comptabilité agricole et l’hygiène sont mis en place dans les écoles de filles ;
- Améliorer le traitement des instituteurs, créer dans les écoles des cours d’adultes et des bibliothèques scolaires.
Cette loi amène la défiance de l’épiscopat à cause de l’inspection à laquelle se trouvent dorénavant soumises les écoles libres tenant lieu d’écoles publiques.
Conditions matérielles améliorées
Dans une circulaire du l4 juin 1868 le ministre invite les préfets à faire distribuer des aliments chauds dans les salles d’asile (maternelles) « aux enfants qu’une nourriture insuffisante étiole ou des vêtements à ceux que les lambeaux de toile défendent mal contre les intempéries ». On notera que le besoin en salles d’asiles augmente avec l’extension de l’industrie et le développement du travail des femmes qui cherchent à faire garder leurs enfants.
En 1860, dans les écoles communales de la ville de Paris, les élèves sont répartis en classes de niveau distinct : 3 cours — élémentaire, moyen, supérieur — dotés de programmes précis ; cette progression, codifiée par Octave Gréard, directeur de l’enseignement primaire de la Seine, est approuvée par Duruy en 1868. L’organisation pédagogique de Gréard devient un modèle de référence.
C’est également sous le Second Empire qu’un matériel scolaire solide et diversifié — tables, bancs, carte murale, globe, mesures de capacités — commence à équiper un réseau d’écoles de plus en plus dense. Enfin, en ce qui concerne le certificat d’études primaires prôné par Guizot, Victor Duruy le recommande dans une circulaire d’août 1866, à charge pour les inspecteurs d’académies d’en apprécier l’opportunité et les modalités ; à partir de 1868 il est délivré par une commission départementale ou cantonale. L’organisation de l’examen ne sera uniformisée qu’en 1880 et rendue obligatoire qu’en 1882.
L’Université Napoléonienne
Dans le secondaire, ce sont la grande loi scolaire du Consulat du 1er mai 1802 et la loi impériale du 10 mai 1806 qui, avec le décret du 17 mars 1808, ont créé l’Université impériale. Les écoles centrales sont supprimées au profit des écoles secondaires prises en charge par les communes ou des particuliers et des lycées entretenus par le Trésor public. Dans les lycées — qui sont créés à raison d’un par tribunal d’appel, soit une trentaine sous le Premier Empire — on réunit les disciplines des anciens collèges — langues anciennes, rhétorique, logique — et celles des écoles centrales — sciences, mathématiques et physique. Les cours sont gradués et les études payantes — 6 000 bourses octroyées —, avec une administration forte — proviseur, censeur, procureur gérant — ; un corps d’inspecteurs généraux est créé. L’organisation de l’Université permet de regrouper tous les enseignants en un seul corps civil, séculier et public dirigé par le grand maître. La France est divisée en académies avec à leur tête des recteurs assistés d’inspecteurs d’académie.
Depuis la réforme Fortoul de 1852, il existe dans les collèges, après la classe de 4e, une bifurcation entre filière littéraire — latin, grec — et filière latin-sciences. En revanche, rien n’est prévu pour l’instruction des jeunes filles si ce n’est la création des trois maisons de la Légion d’honneur le 15 décembre 1805 destinées à accueillir les filles de légionnaires ; en fait, il s’agissait essentiellement de former des épouses et des mères : « Je ne crois pas qu’il faille s’occuper d’un régime d’instruction pour les jeunes filles, elles ne peuvent être mieux élevées que par leurs mères ; les mœurs sont tout pour elles ; le mariage est toute leur destination », affirmait Napoléon Ier.
Au milieu du XIXe siècle, les jeunes filles reçoivent une éducation et une instruction secondaire spécifique assurées par l’Église catholique. La loi Falloux, dispensant les congrégations religieuses du brevet de capacité, renforce de fait ce monopole. On peut dire que, dans ce domaine, les structures sont inexistantes.
Accroissement quantitatif et qualitatif
En ce qui concerne le secondaire, Victor Duruy agit en profondeur. Ses champs d’intervention sont multiples :
- Il augmente le nombre des lycées qui, de 53 en 1848, passent à 81 en 1867 — à la fin du Second Empire 80 % des départements en possèdent un ;
- Dans les programmes, il restitue à la philosophie — réduite à la logique — une large place dans la dernière année du secondaire classique ; il y ajoute l’enseignement de l’histoire contemporaine — le mémorialiste Horace de Viel Castel (1802-1864) lui tient rigueur de ce qu’« il ne ménage ni la Restauration, ni le gouvernement de Louis-Philippe » —, des notions d’économie, de droit civil ou encore des applications industrielles des sciences ;
- Il généralise l’enseignement obligatoire de la musique, du dessin, de la gymnastique introduite par Amoros sous la Restauration ; en 1868, 45 lycées et 22 collèges disposent d’une salle réservée aux cours de gymnastique ; l’année sui-vante, elle devient obliga-toire dans les lycées et collèges communaux ;
- Il supprime la bifurcation après la classe de 4e qui « sépare ce qu’on doit unir lorsqu’on veut arriver à la plus haute culture de l’intelligence » ;
- Il crée, avec la loi du 21 juin 1865, à côté des lycées et collèges classiques l’enseignement secondaire spécial « destiné à dispenser une instruction appropriée aux besoins des industriels, des agriculteurs et des négociants » ; cet enseignement professionnel, plus adapté aux besoins de la région et des activités économiques, ne comprend ni latin, ni baccalauréat, mais porte sur des connaissances immédiatement utiles — mathématiques appliquées par exemple ; les professeurs chargés d’enseigner dans ces établissements furent formés à l’École normale de Cluny ; Duruy estime indispensable que l’enseignement secondaire réponde aux besoins des 24 millions de citoyens occupés par l’agriculture et des 13 millions qui se livrent à l’industrie et au commerce — notons que cet enseignement secondaire spécial sera abandonné en 1902 et supprimé en 1938 ;
- Une circulaire ministérielle du 30 octobre 1867 invite les recteurs à organiser des cours secondaires de jeunes filles, cours payants assurés par des professeurs de collèges et de lycées dans des locaux municipaux : « Il ne faut pas oublier non plus que les femmes sont mères deux fois, par l’enfantement et par l’éducation. Songeons donc à organiser aussi l’éducation des filles car une partie de nos embarras actuels provient de ce que nous avons laissé cette éducation aux mains de gens qui ne sont ni de leur temps, ni de leurs pays. » ; en outre, il pose qu’il faut « au sentiment religieux l’appui d’un sens droit et aux entraînements de l’imagination l’obstacle d’une raison éclairée » ; ces deux assertions suscitent d’autant plus l’hostilité de l’Église — Mgr Dupanloup publie M. Duruy et l’école des filles — que le ministre ne se cache pas d’être libre-penseur ; il est d’ailleurs piquant de relever que le lycée-collège Victor Duruy, dans le VIIe arrondissement de Paris, s’est installé en 1905 dans une institution dirigée par les dames du Sacré-Cœur…
Pour les filles
Plus précisément et toujours en ce qui concerne l’enseignement féminin, un cycle de quatre années doit assurer l’apprentissage de la littérature française, des langues vivantes, du dessin, de la chimie, des sciences et de l’Histoire. Par ailleurs, les jeunes filles, évidemment accompagnées de leurs mères ou de divers chaperons, peuvent également suivre des cours en Sorbonne.
Il ne s’agit pas, dans l’esprit de Duruy, de simples conférences publiques mais d’un cours normal d’études sanctionné par un diplôme. Voilà pourquoi, dans sa circulaire aux recteurs du 30 octobre 1867, il préconise d’accompagner cet enseignement de procédés pédagogiques : « Les jeunes filles qui suivent les cours secondaires ne sont pas des auditeurs de cours de facultés ou de conférences publiques, venus pour passer une heure à écouter un homme d’esprit, sans prendre de notes, ni faire de rédactions au risque de n’emporter qu’un souvenir vague de la leçon. Ce sont des élèves entreprenant de suivre un cours normal d’études et s’assujettissant à une marche régulière, pour arriver au diplôme qui sera la sanction et la récompense de leur travail. »
Le 2 novembre, il remarque : « Si cette entreprise réussissait, nous aurions rendu à la société, aux familles et à l’Université un grand service, nous aurions contribué à faire disparaître le divorce intellectuel qui n’existe que trop souvent entre le mari et la femme. Que de fois l’harmonie n’est-elle pas troublée dans les ménages par ces différences d’éducation, de sentiments et d’idées qui empêchent les deux époux de se comprendre, les font vivre en deux mondes séparés et contraires ».
Soit dit au passage, on mesure par ces propos l’évolution des mentalités entre le Premier et le Second Empire.
Problèmes budgétaires
Quant à l’enseignement supé-rieur, lorsque Duruy devient ministre, il existe quatre facultés, de droit, de médecine, de lettres et de sciences. Celles de lettres et de sciences n’ont pas d’étudiants, ne servant qu’à la collation des grades — baccalauréat, licence, doctorat. Elles manquent de toute façon d’infrastructures — laboratoire, salles de conférences… Claude Bernard se plaint ainsi de l’humble soupente où il doit travailler au Collège de France. Victor Duruy s’efforce d’assurer les moyens de travail en installant des laboratoires de recherche, des salles de conférences et en procurant des livres. Il dote ainsi vingt-six laboratoires d’un matériel moderne.
Aussi, à la fin du Second Empire, le nombre de facultés s’est accru avec Nancy, Douai, Clermont-Ferrand, Poitiers et Marseille. Des cours orientés vers les sciences nouvelles se sont ouverts. Le Centre des arts et métiers a été rééquipé, l’École des langues orientales réorganisée et une École supérieure d’agronomie implantée au Muséum. Là, l’enseignement est donné par des aides naturalistes ; les élèves logent dans un ancien bâtiment du collège Rollin ; les lycées Saint-Louis et Louis-le-Grand sont mis à contribution pour fournir des couchettes, des draps et des matelas. Par ailleurs, le ministre se montre partisan de la liberté de l’enseignement supérieur réclamée par les catholiques, mais pas pour les mêmes raisons : il y voit un moyen de limiter l’influence intellectuelle de l’Église tandis que celle-ci veut pouvoir contrôler ses propres facultés — d’où un débat passionné au Sénat, du 19 au 23 mai 1868, opposant les cardinaux de Bellechose et Donnet à Michel Chevalier, Victor Duruy et Charles Augustin Sainte-Beuve.
Comme tout ministre de l’Instruction publi-que, Duruy connaît des problèmes budgétaires : « La France dépense 25 millions pour une préfecture, 50 ou 60 millions pour un opéra et elle ne peut en dépenser 7 ou 8 pour l’instruction du peuple », constate-t-il avec amertume. Il arrive néanmoins à faire passer le budget des cours d’adultes de 50 000 francs à 1 300 000 francs en 1866 après avoir mis à contribution les conseils municipaux et généraux pour les frais de chauffage, d’éclairage et de livres. De même, si la loi du 21 juin 1865 établit l’enseignement secondaire spécial sans allouer de budget, il se débrouille pour que la ville de Cluny offre son abbaye pour l’accueillir ; des subventions sont allouées par des départements, des bourses fournies par des compagnies de chemins de fer et de simples particuliers. Par ailleurs, il fonde l’Observatoire météorologique de Montsouris dans le palais du bey de Tunis, ornement de l’Exposition universelle de 1867, transporté au parc Montsouris qui venait d’être aménagé.
Inspirateur de Jules Ferry
Victor Duruy crée l’École pratique des Hautes Études par le décret du 31 juillet 1868. Elle propose aux étudiants une formation innovante, basée sur la recherche et des exercices pratiques d’après nature et document. L’école introduit la recherche dans le monde universitaire et en fait un instrument privilégié de formation. Elle recrute ses professeurs sur leur expérience et leur renom. Aucune condition d’âge, de grade, de nationalité n’est exigée des élèves à l’inscription. Quatre sections sont organisées : mathématiques, physique et chimie, sciences naturelles et physiologie et, enfin, sciences historiques et philologiques ; une cinquième, concernant les sciences économiques, est décidée par le décret du 30 janvier 1869, mais elle ne fonctionne pas en fait.
Tous ses discours et ses rapports à l’empereur sont rassemblés dans 1’Administration de l’instruction publique en France 1863-69 et Circulaires et instructions relatives à l’instruction publique. Relevons aussi que celui qui a été maître des enfants royaux de Louis-Philippe et ministre de l’Instruction publique de Napoléon III, sera appelé par Jules Ferry au moment de sa réforme du Conseil supérieur de l’instruction publique — ce qui ne l’empêchera pas de dénoncer le caractère antireligieux de sa politique. Il va participer à l’élaboration de la loi du 21 décembre 1880 relative à l’enseignement secondaire des jeunes filles et se trouver à l’origine de la loi du 28 juillet 1882 créant le baccalauréat de l’enseignement secondaire spécial. On n’oubliera pas non plus que son action s’est étendue jusqu’à la Turquie puisqu’il a lancé la fondation du lycée franco-turc d’Istanbul.
Mal vu du clergé catholique, tant gallican qu’ultramontain, considéré avec suspicion par les républicains — n’a-t-il pas indirectement justifié le 2 décembre 1851 en écrivant à l’empereur : « César, en abattant la République romaine, avait abattu ce qui n’était plus qu’une ombre et une ombre sanglante » ? —, il n’est pas repris dans le cabinet formé en 1869 après la victoire du tiers parti ; Émile Ollivier l’estime pourtant, mais il veut renouveler le personnel politique. Nommé au Sénat, conseiller général du canton de Mont-de-Marsan en 1867 et président du conseil général des Landes de 1869 à 1871, il se présentera ensuite vainement aux élections de 1876, après avoir été porté successivement au sein de l’Académie des inscriptions et belles-lettres en 1873, à celle des Sciences morales et politiques en 1879 et à l’Académie française en 1884 — où il est reçu par le cardinal Adolphe Perraud (1828-1906), un normalien condisciple de Taine.
Philippe Séguin constate dans son Louis-Napoléon le Grand : « L’extension de la gratuité et l’augmentation du nombre des écoles primaires suscitèrent une assez vive irritation dans le clergé. Ce ne fut rien à côté des protestations que souleva de sa part la création d’un enseignement secondaire de jeunes filles : l’Église aurait souhaité conserver la maîtrise totale du secteur, dont la responsabilité ne pouvait incomber, d’après elle, qu’à des prêtres ou à des femmes. Ce n’était pas l’avis de l’impératrice qui contribua activement à imposer la réforme en faisant suivre par ses nièces espagnoles ce nouvel enseignement qui, à la fin de l’Empire, était dispensé à la Sorbonne et dans quarante-quatre villes de province. […] Au total, le bilan de l’action conduite est impressionnant. Les initiatives que prendra la IIIe République sont largement préparées, facilitées, anticipées. Il est absolument contraire à la vérité de soutenir que l’Empire, indifférent à l’évolution de l’enseignement public, a abandonné au clergé le soin d’assurer le minimum d’éducation compatible avec la stabilité sociale, et qu’il faut attendre 1870 — voire 1879 et le triomphe radical — pour voir enfin ouverts au peuple les chemins de l’instruction. »
Jean Étèvenaux
Bibliographie et sources :
- Geslot (Jean-Charles), Victor Duruy. Historien et ministre (1811-1894), Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2009, 424 pages,
- Pichot-Bravard (Philippe), Le pape ou l’empereur. Les catholiques et Napoléon III 1848-1870, Perpignan, Tempora, 2008, 208 pages
- Rohr (Jean) Victor Duruy, ministre de Napoléon III. Essai sur la politique de l’Instruction publique au temps de l’Empire libéral, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1967, 216 pages
- Serodes (Françoise), “Victor Duruy, ministre de l’Instruction publique de Napoléon III. Son action dans l’histoire des palmes académiques et dans les divers ordres d’enseignement de 1863 à 1882“, in Revue de l’Amopa, n° 181, juillet 2008, pp. 8-12